L’expression « le Fils de l’homme » (ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου) constitue sans doute la crux interpretum la plus complexe et la plus déterminante de la christologie néotestamentaire. Sa prééminence statistique dans les Évangiles synoptiques, où elle forme l’auto-désignation quasi exclusive de Jésus, contraste de manière saisissante avec sa quasi-disparition dans le reste du corpus du Nouveau Testament, notamment les écrits pauliniens. Ce paradoxe, entre une centralité évangélique indéniable et une marginalisation apostolique apparente, soulève la problématique fondamentale : quelle fonction théologique cette appellation énigmatique remplit-elle dans l’auto-compréhension de Jésus et dans le développement subséquent de la doctrine christologique ? Loin d’être un simple archaïsme ou une périphrase obscure, le « Fils de l’homme » s’avère être un véhicule sémantique d’une extraordinaire densité, porteur d’une tension inhérente entre l’abaissement et la gloire, la fragilité humaine et la souveraineté divine.
Origines vétérotestamentaires
L’arrière-plan scripturaire du « Fils de l’homme » est double, reposant sur deux traditions linguistiques et théologiques distinctes, voire opposées. La sémantique de l’expression porte en elle une ambiguïté fondamentale qui s’avérera essentielle pour son utilisation christologique ultérieure.
La première tradition est hébraïque, utilisant les termes ben ‘adam (fils d’Adam) ou ben ‘enosh (fils de l’homme mortel). Dans cette acception, l’expression désigne la condition humaine dans sa précarité et sa finitude. Le Psaume 8:4-6 l’emploie pour souligner l’étonnante élection de l’homme par Dieu malgré sa petitesse. C’est toutefois dans le livre d’Ézéchiel que cet usage atteint son apogée. Près de quatre-vingt-dix fois, le prophète est interpellé par Dieu sous ce vocable : « Fils d’homme, tiens-toi sur tes pieds… ». Comme le souligne l’exégèse, cette interpellation sert à accentuer la distance ontologique abyssale entre la majesté divine et la fragilité de la créature terrestre. Le ben ‘adam est ici le symbole de l’humanité mortelle en dialogue avec le Transcendant.
La seconde tradition, radicalement différente, est araméenne et émerge du contexte apocalyptique. La vision de Daniel 7:13-14 est le texte séminal. Le prophète contemple « quelqu’un de semblable à un fils d’homme » (en araméen kê-bar ‘enash) qui vient « sur les nuées du ciel ». Ce détail est crucial : les nuées sont, dans l’Ancien Testament, le véhicule de la divinité. Cette figure s’avance jusqu’à l’Ancien des Jours et reçoit « la domination, la gloire et le royaume » pour l’éternité. Si l’interprétation de cette figure (parfois vue comme une personnification collective d’Israël, le peuple des saints) est débattue, le texte pose les fondements d’une figure transcendante, céleste et investie d’une souveraineté eschatologique.
L’ambiguïté fondamentale du « Fils de l’homme » est donc déjà présente dans le corpus vétérotestamentaire. L’expression oscille entre la faiblesse (Ézéchiel) et la puissance divine (Daniel). Cette tension sémantique non résolue n’est pas une confusion ; elle est la caractéristique inhérente qui rendra ce titre si apte à être revendiqué par Jésus. Il est le seul vocable scripturaire capable de contenir le paradoxe central de l’Incarnation : l’union de l’abaissement le plus total et de la gloire souveraine.
La maturation intertestamentaire
Durant la période du Second Temple, le judaïsme apocalyptique ne va pas laisser en friche la figure énigmatique de Daniel 7. Au contraire, il va la développer, la systématiser et, ce faisant, résoudre son ambiguïté. La littérature hénochique, en particulier le Livre des Paraboles (ou Similitudes, 1 Hénoch 37-71), atteste d’une évolution théologique majeure.
S’emparant de la vision daniélique, l’auteur des Paraboles transforme le bar ‘enash en une figure messianique spécifique et individuelle. Il n’est plus « semblable à » un fils d’homme ; il est le « Fils de l’homme ». Ce personnage reçoit d’autres titres, notamment celui de « l’Élu ». Ses attributs sont développés : il est décrit comme préexistant à la création du monde, son nom ayant été « nommé devant le Seigneur des esprits avant que le soleil et les signes ne fussent créés ». Sa fonction principale est clarifiée : il est le Juge eschatologique, caché par Dieu, qui sera révélé à la fin des temps pour juger les rois et les puissants, et pour apporter la justice aux élus.
D’autres textes, comme le 4 Esdras (ou 2 Esdras), bien que leur datation soit complexe (contemporains ou légèrement postérieurs au christianisme primitif), témoignent d’une attente similaire d’un Juge messianique céleste, décrit comme un « homme » émergeant de la mer pour exécuter le jugement divin.
Cette maturation intertestamentaire a des implications considérables pour la christologie. Des travaux récents (notamment ceux de Daniel Boyarin) suggèrent que l’émergence d’une figure divine « seconde », un vice-roi de Dieu exerçant sa souveraineté, n’était pas une hérésie pour certains courants du judaïsme, mais une trajectoire théologique indigène, parfois qualifiée de « binitarisme ». La « haute christologie » (Jésus comme figure divine préexistante) ne serait donc pas, comme une certaine critique l’a longtemps soutenu, une corruption hellénistique tardive, mais plutôt l’identification de Jésus de Nazareth à une attente messianique spécifique, déjà présente au sein même du judaïsme apocalyptique.
L’auto-désignation et la classification synoptique
C’est dans ce contexte théologique complexe que Jésus s’approprie l’expression. Le fait exégétique le plus saillant des Évangiles est que « le Fils de l’homme » est une auto-désignation. Alors que les disciples (Pierre), les démons ou même un centurion romain peuvent le confesser comme « Christ », « Saint de Dieu » ou « Fils de Dieu », Jésus, lui, utilise quasi exclusivement « le Fils de l’homme » pour parler de lui-même à la troisième personne.
La recherche exégétique, depuis Bultmann, classe traditionnellement les logia (paroles) du Fils de l’homme en trois catégories :
- Le Fils de l’homme terrestre (Autorité) : Ce sont les paroles où Jésus utilise le titre pour affirmer son autorité présente et sur la terre. Il revendique le pouvoir de pardonner les péchés (Marc 2:10) et se déclare « Seigneur même du sabbat » (Marc 2:28), s’attribuant une autorité divine sur la Loi. C’est aussi dans cette catégorie que se trouve la description de sa kénose terrestre : « Le Fils de l’homme n’a pas où reposer sa tête » (Matthieu 8:20).
- Le Fils de l’homme eschatologique (Gloire) : Ces logia sont en lien direct avec Daniel 7 et 1 Hénoch. Jésus annonce sa venue future « dans la gloire de son Père » (Matthieu 16:27) et « venant sur les nuées du ciel » (Marc 14:62). Dans cette fonction, il est le Juge eschatologique qui « s’assiéra sur le trône de sa gloire » pour le jugement des nations (Matthieu 25:31).
- Le Fils de l’homme souffrant (Passion) : C’est la catégorie la plus innovante et théologiquement la plus dense. Après la confession de Pierre à Césarée, Jésus inaugure un nouvel enseignement, répété à trois reprises : « Il faut que le Fils de l’homme souffre beaucoup, qu’il soit rejeté… qu’il soit mis à mort, et qu’il ressuscite » (Marc 8:31).
L’innovation christologique radicale de Jésus réside dans la fusion de ces catégories. L’attente juive (Daniel, Hénoch) connaissait un Fils de l’homme glorieux et juge ; il ne souffrait jamais. L’annonce de Marc 8:31 est donc un véritable scandale théologique, une contradiction dans les termes, que Pierre rejette d’ailleurs avec véhémence. Jésus opère ici une synthèse que personne n’avait faite avant lui : il fusionne la figure glorieuse du Bar ‘Enash (Daniel 7) avec celle, méprisée et souffrante, du ‘Ebed YHWH (le Serviteur de YHWH) d’Isaïe 53. Le « Fils de l’homme » devient, dans sa bouche, le titre composite qui explique que le chemin vers la gloire eschatologique (Daniel) passe nécessairement par la souffrance vicaire (Isaïe).
Le débat exégétique contemporain
La signification précise de l’expression a fait l’objet d’un débat académique intense, connu comme le « Son of Man Problem ». La position exégétique traditionnelle (incarnée par des figures comme Cullmann ou Bultmann, malgré leurs divergences) a longtemps considéré « le Fils de l’homme » comme un titre christologique préexistant, chargé de la gloire apocalyptique, que Jésus se serait consciemment appliqué.
Cependant, une thèse alternative, vigoureusement défendue par Geza Vermes et suivie par d’autres (comme Maurice Casey ), soutient que l’expression grecque ho huios tou anthrōpou est une traduction maladroite d’une périphrase araméenne commune, bar nasha. Dans ce contexte idiomatique, bar nasha ne serait pas un titre, mais signifierait simplement « l’homme » (au sens générique) ou, par circonlocution, « moi ».
Cette seconde thèse s’appuie notamment sur certains logia où Jésus semble opérer une distinction entre lui-même et le Fils de l’homme. L’exemple le plus célèbre est Luc 12:8 : « Quiconque se déclarera pour moi devant les humains, le Fils de l’homme aussi se déclarera pour lui… ». Si « moi » et « le Fils de l’homme » sont identiques, la phrase est redondante ; s’ils sont distincts, la christologie traditionnelle est ébranlée. Il est d’ailleurs notable que l’évangéliste Matthieu, dans son parallèle (Matthieu 10:32), semble gêné par cette distinction et la « corrige » : « …je me déclarerai moi aussi pour lui… », ramenant ainsi le Fils de l’homme au « je » de Jésus.
La résolution de ce débat n’est probablement pas un « soit/soit ». Il est méthodologiquement plausible que Jésus ait commencé par utiliser l’expression idiomatique (la thèse de Vermes) précisément en raison de son ambiguïté. L’expression bar nasha lui permettait de parler de sa mission et de son autorité (Mc 2:10) sans revendiquer publiquement les titres politiquement inflammables de « Messie » ou de « Roi d’Israël ». L’ambiguïté linguistique (parle-t-il de « l’Homme » ou de « moi » ?) servait de voile pédagogique à l’ambiguïté théologique (est-il un simple homme ou le Juge eschatologique ?).
Dans cette perspective, les logia de distinction (comme Lc 12:8) trouvent une explication cohérente : Jésus, durant son ministère terrestre (le « moi »), parle du Juge eschatologique (le « Fils de l’homme ») comme d’une figure future, un allié céleste qui viendra valider et vindicter sa mission terrestre. La pleine et explicite identification entre le « moi » de Jésus et le « Fils de l’homme » de Daniel 7 n’est révélée qu’à la toute fin, lors de son procès devant le Sanhédrin (Marc 14:62), où il fusionne son identité présente avec sa fonction eschatologique future.
Synthèse christologique
Au-delà du débat philologique, la fonction théologique du « Fils de l’homme » est d’articuler le cœur du mystère chrétien : l’union de la kénose et de l’exaltation.
D’une part, le titre est le vecteur de la kénose (l’abaissement). Il ancre le Logos dans la condition humaine (le ben ‘adam d’Ézéchiel). C’est en tant que « Fils de l’homme » qu’il souffre , qu’il sert et « donne sa vie en rançon pour beaucoup » (Marc 10:45) , et qu’il expérimente la précarité humaine. C’est le titre de son abaissement volontaire, qui trouve son parallèle théologique dans l’hymne de Philippiens 2:6-8.
D’autre part, ce même titre est la garantie de l’exaltation (la gloire de Daniel 7). C’est en tant que « Fils de l’homme » qu’il est glorifié, qu’il siège à la droite de la Puissance et qu’il détient l’autorité du jugement universel.
Il convient de distinguer cet usage de celui de « Fils de Dieu » (ou simplement « le Fils », ho huios). Un logion synoptique crucial, souvent qualifié de « météorite johannique » pour sa haute christologie, se trouve en Matthieu 11:27 et Luc 10:22 : « Nul ne connaît le Fils si ce n’est le Père, et nul ne connaît le Père si ce n’est le Fils… ». Ici, Jésus n’utilise pas « Fils de l’homme ». La terminologie semble se spécialiser : « Fils de Dieu » (ou « le Fils ») tend à décrire sa relation ontologique unique avec le Père, sa filiation divine éternelle. L’expression « Fils de l’homme », quant à elle, tend à décrire sa mission économique dans l’histoire du salut : son incarnation, sa passion et sa fonction de juge.
L’identité ontologique (« le Fils ») est le fondement de la mission économique (« le Fils de l’homme »). Comme le suggère une analyse de Matthieu 11:27 , c’est parce que Jésus est le Fils dans une relation unique au Père qu’il peut, en tant que Fils de l’homme, venir révéler à l’humanité sa propre vocation de « fils de Dieu », inscrite dans la théologie de la création.
La réception post-pascale
Après la Pâque, l’usage de l’expression s’effondre quantitativement. Elle était l’ipsissima vox de Jésus, liée à sa pédagogie terrestre de la révélation ambiguë. L’Église primitive, s’adressant à un monde gréco-romain pour qui l’idiome araméen bar nasha était inintelligible, a privilégié des titres plus universels et moins ambigus, tels que Kyrios (Seigneur) ou Huios Theou (Fils de Dieu).
Néanmoins, les rares occurrences post-évangéliques sont d’une importance théologique capitale et se concentrent exclusivement sur la figure glorifiée.
- Actes 7:56 : La seule fois où une autre personne que Jésus utilise ce titre. Lors de son martyre, Étienne, rempli de l’Esprit Saint, lève les yeux au ciel et s’écrie : « Voici, je vois les cieux ouverts, et le Fils de l’homme debout à la droite de Dieu ».
- Hébreux 2:5-9 : L’auteur cite le Psaume 8 (« Qu’est-ce que l’homme… ou le fils de l’homme… »). Il applique cette description de l’humanité à la trajectoire de Jésus : il a été « fait un peu moindre que les anges » (la kénose) afin de « goûter la mort pour tous » (la Passion) , avant d’être « couronné de gloire et d’honneur » (l’exaltation).
- Apocalypse 1:13 et 14:14 : L’expression revient à ses origines daniéliques. Jean voit « quelqu’un qui ressemblait à un fils d’homme ». C’est une description visionnaire du Christ glorifié, agissant comme souverain sacrificateur (Ap 1) et comme moissonneur eschatologique armé d’une faucille (Ap 14).
La vision d’Étienne (Actes 7) offre une conclusion théologique parfaite au ministère de Jésus. Devant ce même Sanhédrin, Jésus avait promis : « vous verrez le Fils de l’homme assis à la droite de la Puissance… » (Marc 14:62). Étienne, le premier martyr, est le premier témoin qui voit cette promesse accomplie. Le détail qu’il soit « debout »(hestōta) et non « assis » (kathēmenon, comme au Psaume 110:1) est théologiquement dense : le Christ glorifié n’est pas statique ; il se lève, actif, pour accueillir son témoin et agir comme son avocat céleste au moment même de son jugement terrestre. Le cycle de l’auto-désignation de Jésus est complet.
En conclusion, l’expression « Fils de l’homme », loin d’être un titre archaïque ou confus, se révèle être la clé herméneutique la plus sophistiquée de la christologie. Elle est la formule choisie par Jésus lui-même pour encapsuler l’intégralité du mystère de sa personne et de son œuvre : la fragilité de l’Adam terrestre, la souveraineté transcendante de la figure daniélique, la mission vicaire du Serviteur souffrant d’Isaïe, et la gloire finale du Juge eschatologique.
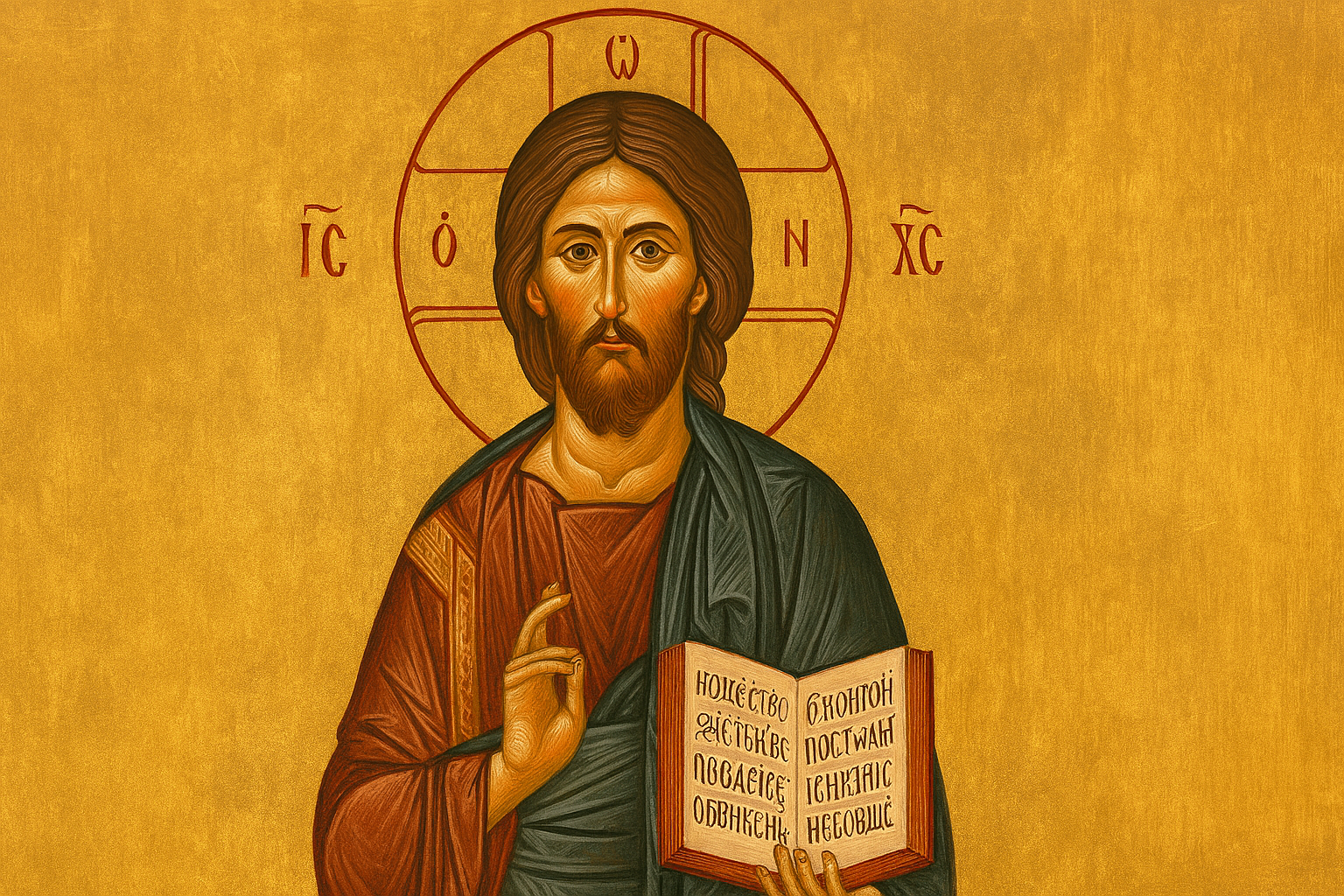
Laisser un commentaire